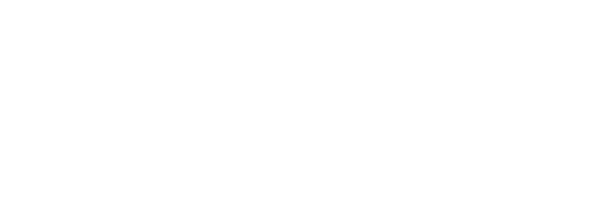Thème 2
Justice
Responsable : Vincent MARTIN
Selon une définition ancienne et toujours actuelle, la justice est l’art d’« attribuer à chacun le sien ». Depuis longtemps, l’étude de cette notion revêt un intérêt capital. Aujourd’hui comme hier, étudier les institutions chargées de rendre justice et les procédures qui régissent les contentieux, appréhender également la mise en œuvre, devant les juridictions, des règles juridiques, est une œuvre indispensable pour mieux réfléchir aux évolutions du droit. Au-delà et depuis de longs siècles déjà, la justice est regardée comme la condition sine qua non de toute paix véritable au sein du corps social : la stabilité de la communauté politique dépend de la bonne exécution de cette mission essentielle. La justice est donc située à la confluence d’enjeux juridiques et politiques, raison pour laquelle il a été décidé d’en faire un thème structurant pour la recherche au sein du CUREJ, destiné à impliquer tous les pans académiques du droit (droit privé, droit public, histoire du droit) et la science politique.
Comprendre la justice implique une réflexion sur le temps long, avec des perspectives historiques, car les institutions et les règles qui nous régissent ont souvent des racines profondes dont il faut appréhender les origines pour bien en saisir le sens et la finalité. Au-delà et d’un point de vue contemporain, le thème de la justice revêt un intérêt particulier en raison de la conjoncture actuelle. On sait en effet que les institutions judiciaires ont connu ces dernières années de profondes mutations auxquelles a encore contribué la récente loi pour la confiance dans l’institution judiciaire du 22 décembre 2021. Depuis une longue décennie déjà, la justice est au cœur de réformes importantes qui font évoluer, parfois en profondeur, les professions judiciaires, l’organisation juridictionnelle et les modes de résolution des conflits. Par ailleurs, en réponse à une préoccupation ancienne mais qui exige des réponses sans cesse actualisées, la déontologie et la discipline des officiers publics et ministériels font l’objet d’une vigilance particulière de la part des gouvernants. Enfin, le rôle des institutions judiciaires mérite une attention sans cesse renouvelée en un temps marqué par l’évolution rapide des règles de fond dans de nombreux domaines.
Ainsi, étudier la justice mène à s’intéresser à des institutions et des normes évolutives, mais confronte également le chercheur à des institutions et des procédures qui, pour certaines, obéissent à des principes très anciens, quasi immuables, qui puisent parfois, au-delà du legs des périodes récentes, dans l’héritage de l’ancienne France. À la lumière de ce constat, il apparaît essentiel de réfléchir à la justice sous le prisme des permanences et des mutations. Dans cette perspective, trois principaux axes de réflexion sont envisagés :
- Les institutions et métiers de la justice
- Les modes de règlement des conflits
- Les normes